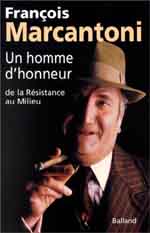Escale à Pigalle |
|
| Le nom sulfureux de François Marcantoni nous donne l’occasion de reproduire quelques articles parus récemment dans la presse (ParisObs 08/10) qui reviennent sur la faune qu’André Pousse a pu côtoyer, ou pas, lorsqu’il était une figure de Pigalle. Autant de voisinages, sinon de fréquentations, qui lui auront permis d’affiner ses rôles de truands…et que nous sommes ravis de ne jamais avoir croisés. | |
Marcantoni, l’élégant |
|
| Il a 84 ans, un air de parrain à la Scorsese qui fait le bonheur des plateaux télé. Il fustige avec morgue le gangstérisme actuel. L a démarche trahit le poids des années mais la formule fait encore mouche. Le Fouquet’s ? « C’est devenu un restaurant pour routiers ! » Son entrée dans le milieu ? « Une fois goûté au champagne, la limonade m’a parue fade. » Sa fiche au grand banditisme ? « Je l’ai accrochée dans un beau cadre doré. » | |
|
|
A 84 ans et même sans
son célèbre borsalino, François Marcantoni excelle
dans son rôle de figure truculente du milieu, bandit médiatique
vu chez Bouvard ou Dumas. « Je ne sais pas si ce
fut un vrai parrain. Mais en tout cas il aime bien jouer
ce rôle », avance un connaisseur du milieu. Blazer
bleu, lunettes noires, chemises à rayures à ses
initiales, lorsqu’il pénètre dans cette brasserie
des Ternes, les serveurs lui donnent du « Monsieur
Marcantoni », le maître d’hôtel s’écarte
sur son passage. Pour un peu, on se croirait chez
Scorsese. Originaire d’Alzi, en Corse, il s’est engagé dans la Résistance, fut torturé par la Gestapo. A la Libération, il détrousse d’anciens collabos et monte le cabaret Les Calanques, rue Quentin-Bauchart, avec le frère de Tino Rossi. Il tâte aussi du braquage, dit avoir fait partie du gang des tractions avant. Proche du SAC, il joue les agents électoraux : « J’ai assuré le service d’ordre pour la campagne de Robert Hersant dans l’Oise », dit-il entre deux bouffées de Montechristo. Marcantoni le facétieux qui, lorsqu’un jour un inspecteur de police lui enjoint de se tenir à carreau, revient le lendemain au commissariat avec une chemise à carreaux. En 1969, il est soupçonné du meurtre de Markovic, avant d’obtenir un non-lieu sept ans plus tard. A 73 ans, il retournera en prison suite à une affaire de tableaux volés. Quartier VIP, en compagnie du préfet Bonnet et de Bob Denard. |
| Aujourd’hui, Marcantoni dit avoir des occupations de retraité : Loto, tiercé, théâtre. Mais fustige avec morgue le gangstérisme actuel : « Avant, il y avait un code d’honneur. Une morale. Des règles. Quand les flics faisaient une descente, ils n’avaient pas besoin de gilets pare-balles. Aujourd’hui on tire au bazooka sur les convoyeurs. » Les truands, aussi, sont nostalgiques… Vincent Monnier | |
Pigalle d’antan : la dernière séance |
|
| Palissades de travaux en champ visuel, klaxons qui éructent en fond sonore, gaz d’échappement en accompagnements olfactifs. Ce jour-là, le boulevard de Clichy a tout du capharnaüm urbain. Assis à la terrasse du Chat noir, Gégé le Catcheur et Gilbert de la Butte-aux-Cailles contemplent le fatras et pestent contre la rhétorique municipale : « Il paraît qu’ils veulent faire de Pigalle un “espace civilisé”. Pigalle espace civilisé, on croit rêver ! » Demain, Delanoë leur promet de la verdure, des pistes cyclables, des espaces à vivre. Demain, ils s’en foutent. Ils regrettent hier. Le Pigalle d’Auguste le Breton, des fêtes foraines et des tripots : « Le plus fameux, c’était le Petit Jardin, une boîte réservée aux voyous le mardi soir », raconte Gilbert, qui a tenu une baraque à strip-tease sur le boulevard. Cinq francs les cinq strips. « Les filles rencontraient des julots qui leur payaient des robes, des bijoux, les emmenaient au restaurant. Et puis, prétextant des problèmes d’argent, ils les envoyaient aux asperges. » Rencontrés par l’entremise de Claude Dubois, l’auteur de « Paris Gangster », les deux sont d’anciens catcheurs qui ont grenouillé dans les arcanes du Paris interlope. Ils ont filé des coups de main, de poing à l’occasion. Ils parlent l’argot, l’Audiard, une langue presque morte truffée de « nave, cave, pains de fesse ». Tous deux approchent la soixantaine. Solide gaillard, Gégé rêve de cinéma mais pour l’instant travaille dans un « cabaret » du boulevard où les gogos ne sont pas seulement les danseuses qui s’effeuillent. Gilbert, lui, voyage : Colombie, Italie, Israël… « Pigalle, c’est foutu, explique-t-il. Les lieux ont fermé. Les plus durs n’ont pas passé la quarantaine ou bien ont terminé à l’hospice, au milieu de ceux qu’ils détestaient, les “boulots”, ces ouvriers qui allaient au turbin chaque matin. » Gégé se lève précipitamment : « Désolé, j’ai un client ! » Une denrée rare. On continue notre balade à la recherche du Montmartre d’antan. La réminiscence s’appelle Pierrot. On le retrouve à La Midinette, un rade de poche, accoudé au comptoir. En salle, on reconnaît un acteur de « Sous le Soleil », série sirupeuse de TF1. Une gueule à la Lee Marvin, des yeux bleus délavés, une verve de titi parigot. Petit, une voyante lui avait prédit qu’il serait aviateur. Pierrot a préféré faire monte-en-l’air. Il affiche 59 ans au compteur, 32 passés au placard. Braquages, prison, évasions… Ce fut la vie de Pierrot, ennemi public n° 1 en novembre 1978. Il a écrit un livre, « la Vie sur place » : « Fallait bien que je pense à ma retraite ! » Il a fait Ardisson, Taddéi, « Télé 7 Jours ». De nos jours, les braqueurs passent de l’ombre aux projos des médias. Lui qui a toujours vécu à Pigalle n’a pas reconnu son quartier. « Pas ma tasse de thé, les bobos ». Il s’est replié sur les quelques lieux où « on croise encore des anciens » : Chez Amad, Au Vrai Paris, la Midinette. Des espaces pas encore civilisés. Vincent Monnier | |
Le Milieu n’est plus au centre |
|
| Non, le milieu n’est pas mort. Même s’il a muté ces dernières années, ses bars, eux, n’ont pas tous tiré le rideau, disparu avec la pègre d’antan, celle de Gaby le Stéphanois, de Julot des sables ou d’Armand les yeux bleus. Les zincs, c’était le havre du voyou, là où on retrouve les connaissances, laisse les messages et les paquets compromettants. Les balises de la nuit malfrate. Certes, les hauts lieux ont fermé. Montmartre s’est vidé, et les portes Saint-Martin et Saint-Denis sont depuis longtemps désertées. Les affranchis ont désormais leurs adresses du côté de La Plaine-Saint-Denis, de Saint-Ouen et surtout d’Aubervilliers. Pas de berlines luxueuses garées devant, ni de clinquant dans la décoration, on est là pour boire entre « hommes ». Des établissements de rien, dissimulés dans la zone, qui accueillent mille ans de prison. Jérôme Pierrat | |
Liberi Montmartru ! |
|
| Dans les années
50, à Montmartre, l’accent rocailleux de l’île
de Beauté est un passeport pour la pègre. Et le petit
truand en mal de reconnaissance, monté de sa banlieue
parisienne ou de Bretagne, n’hésite pas à l’usurper.
Tentant pour se faire un nom, mais risqué. Le bas de la
butte est le royaume des Corses. Ils ne sont pas les
seuls à fréquenter le coin, bien sûr, mais ils y sont
les plus nombreux. Depuis la Première Guerre mondiale, le truand d’Ajaccio ou de Bastia exerce sa spécialité – le maquereautage – dans la capitale. Jusque-là, les « garçons » s’étaient contentés de la Côte, Marseille et son quartier Saint-Jean, Toulon et son Chapeau rouge, Avignon pour les interdits de séjour… Depuis la fin du Second Empire, l’économie de l’île est à l’agonie, conséquence d’une grave crise agricole qui a touché divers secteurs de la production : vignoble phylloxéré, céréaliculture concurrencée par les blés étrangers, production laitière sans débouchés… L’émigration explose à partir de 1890. Aux côtés des fonctionnaires et des coloniaux, les mauvais garçons locaux s’exportent. Massivement dans le Sud, plus timidement à Paris. A la Belle Epoque, les quelques insulaires fréquentent le faubourg Montmartre, le haut du panier proxénète. Traitants de chair humaine, ils viennent faire leurs courses à destination des bordels du Sud et, surtout, de ceux d’Afrique du Nord où ils règnent en maîtres. Puis, comme les autres provinciaux, les Corses montent durablement à la capitale après la Première Guerre mondiale. Les aînés, qui ont fait leurs classes à Marseille, s’installent dans le triangle d’or, entre la place Clichy, Pigalle et Saint-Georges. Et font venir les « petits », jeunes bergers analphabètes descendus de leurs villages. On leur met le pied à l’étrier, ou plutôt Robert Guitton, un caïd des boulevards, tombe sous les balles de Jean Petit, du village d’Olmetto, à qui il voulait souffler Mimi la Rouge ; René le Placeur est tué par Grisoni, dit Antoine le Frisé ; Louis la Guinche et Gilles le Pierrot sont fumés devant un bar corse de la rue Fontaine… La communauté s’installe à coups de flingue et investit dans les bars. Rue Fontaine ouvrent Le Lisieux et le Bar mondain. Rue de Douai, c’est le Bar du cinéma, surnommé chez Dante, qui accueille les caïds. Lorsqu’ils quittent leurs bureaux, les « hommes » mangent la bouillabaisse chez Nine, rue Victor-Massé, fréquentent chez Alexis, un Ajaccien qui reçoit le gratin de l’île, et écoutent un jeune chanteur qui monte, Tino Rossi, à la crèmerie de la rue Le Chapelais. Soudées dans l’adversité, les différentes bandes emmenées par les caïds – Joseph Marini dit le Capitaine, les frères Stéfani, Louis Poli… – ne vont pas tarder à s’affronter entre elles. C’est le début des vendettas qui ne cesseront d’ensanglanter le pavé du 9 e durant les quarante ans de règne des îliens. Jusqu’à la fin de Montmartre, devenu Pigalle, qui se meurt dans les années 1970. Les guerres ont éclairci les rangs et le proxénétisme est plus durement réprimé. Les jeunes de l’île partent maintenant faire leurs études supérieures sur le continent. L’illettrisme des petits bergers n’est plus d’actualité. Autour des places Pigalle et Blanche, leur accent a désormais cédé la place à celui des touristes allemands. Jérôme Pierrat |
|
Particule, gros calibre |
|
| Une gueule de croque-mort, une réputation d’assassin, mais un nom à particule. Gaëtan Lherbon, baron de Lussats, est sans doute le seul noble à avoir abandonné les armoiries familiales au profit du costume rayé et des pompes bicolores. Sa famille compte de brillants aînés : son grand-père, le général de division Lherbon de Lussats, a commandé les forts d’Aumale et son oncle, le général Amédée Guérin de Tourville, a présidé le Conseil de la guerre. Le baron, lui, sera truand. A 9 ans, orphelin de son père le marquis, il fugue avant d’être repris à la frontière italienne. A 13 ans , on le retrouve sur un cargo à Nice, déguisé en mousse. Après deux ans d’une vie de souffrances et de misère, il atterrit à Londres comme serveur. Au Café français de Dey Street, exactement. Un repaire de souteneurs français, évadés, tricards, voleurs et autres escrocs. Il y apprend la mentalité et les traditions qui régissent le milieu. Fort de son expérience et de ses recommandations, Gaëtan débarque à Montmartre en 1906, à 18 ans. Et prend rapidement la direction de la Santé pour recel. En sortant, le garçon enchaîne les bagarres au rasoir et gagne ses premiers galons dans la pègre. Il devient Gaston Baron, gentleman des boulevards extérieurs. En 14, il s’engage pour la durée des hostilités. De retour sur le pavé parisien en 1920, l’aristo tue un certain Fournier lors d’une partie de cartes dans une chambre d’hôtel de la rue de Douai. Légitime défense. Le jeu lui réussit, Gaëtan en fait sa spécialité . Sa réputation grandit. En 27, il tient un restaurant de nuit au cœur de Montmartre, le Grand Capitole, avant d’ouvrir deux ans plus tard le Grand Duc. Une boîte pour « invertis », comme on dit à l’époque. Le baron rentre dans l’intimité des hommes politiques pour qui il organise des soirées privées. Le baron circule maintenant en cabriolet bleu, habillé par les meilleurs tailleurs. On s’adjoint ses services. Pour assurer la sécurité du prince Carol de Roumanie et celle d’Henri Torrès, pour défendre la légitimité princière de Monaco en 1928, pour épauler les parrains de Marseille, Carbone et Spirito (avec qui il est associé dans des cercles de jeu à Paris), lors de la campagne municipale de 1932… Cinq ans plus tard, il pose définitivement son sac sur la Côte d’Azur. Grâce à ses relations, le truand décroche l’autorisation d’installer des machines à sous dans la principauté. Il y meurt riche et vieux en 1962. Jérôme Pierrat | |
Pierrot le Fou |
|
| Il fut le premier
ennemi public n°1 de l’histoire. Fils de paysan,
truand à la petite semaine, gestapiste de la rue
Lauriston puis résistant de la 11 e heure. A la Libération,
avec son « Gang des tractions avant », une équipe
d’ex-collabos et de résistants, il se lance dans le
braquage. Banques, fourgons, usines, tout y passe. Le 6
novembre 46, suite à un casse raté chez un bijoutier de
la rue Boissière, il se tire une balle dans la vessie en
voulant ranger son pistolet. Ses complices l’enterrent
clandestinement sur l’île de Limay. Jusqu’en
49, la police lui attribuera des casses. Vincent Monnier |
|